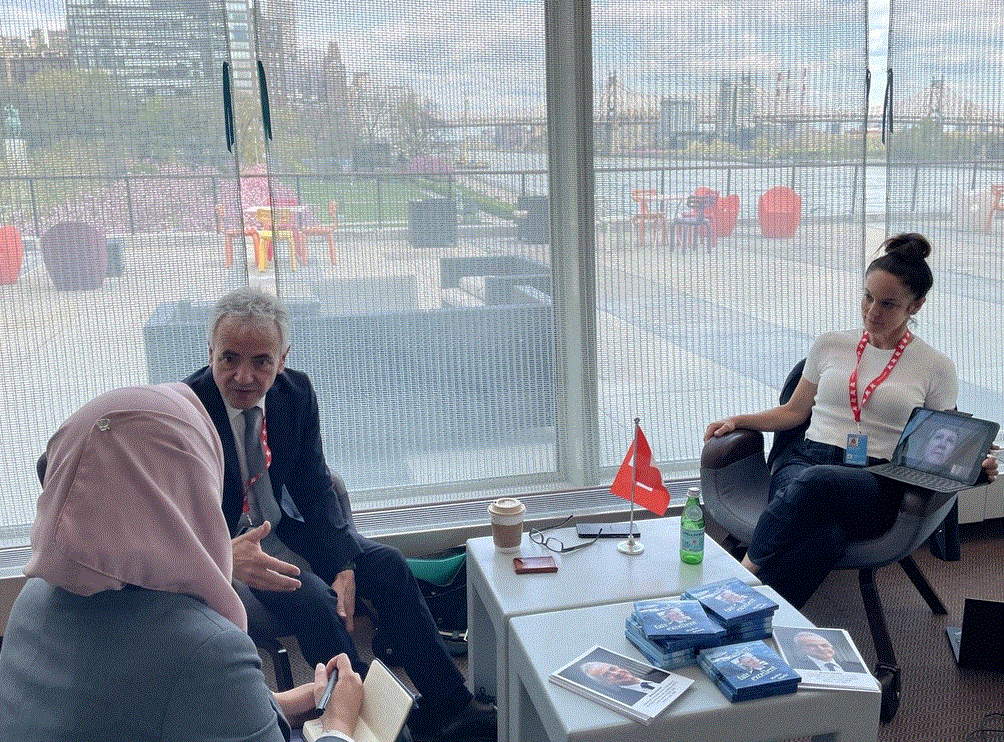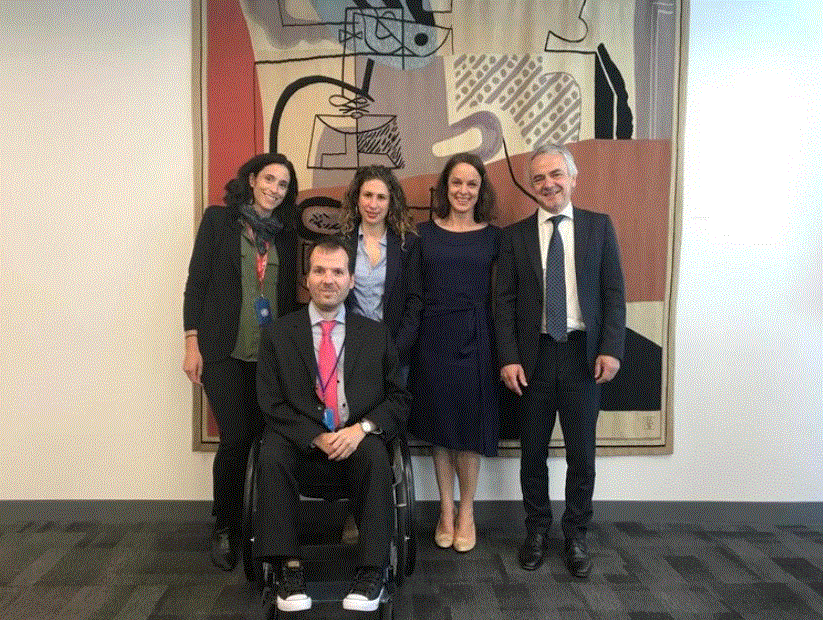(Le Temps)
Markus Schefer est membre du Comité de l’ONU chargé de veiller au respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le professeur de droit à l’Université de Bâle s’exprime sur la Suisse, qui vient d’être sévèrement évaluée pour sa mise en œuvre lacunaire de ce texte ratifié en 2014

Bâle, le 11 mai 2022. Le professeur Markus Schefer, devant les locaux de la Faculté de droit, où il enseigne le droit constitutionnel. — © Katja Schmidlin/Lunax pour Le Temps
Le monde du handicap est en ébullition. Les critiques sévères que l’ONU a adressées à la Suisse, fin mars, en examinant sa mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) ou, à Genève, les cas de maltraitance survenus au foyer pour mineurs de Mancy et les dysfonctionnements constatés à Clair Bois éclairent une problématique longtemps négligée par les pouvoirs publics. Législation, hébergement, curatelle, langage, éducation et emploi constituent autant d’immenses chantiers qu’il conviendrait d’ouvrir à l’échelle cantonale et fédérale pour se conformer à ce texte ratifié en 2014 par la Confédération.
Markus Schefer est professeur de droit constitutionnel à l’Université de Bâle et siège depuis 2019 au comité de l’ONU qui veille au respect de la CDPH par les Etats signataires. Il est actuellement en campagne pour effectuer un second mandat lors d’une élection qui se tiendra le 14 juin à New York.
Le Temps: En quoi consiste votre travail au sein du comité de l’ONU?
Markus Schefer: Je suis le rapporteur des communications individuelles, entre autres. Les habitants des 100 Etats ayant ratifié le protocole facultatif – ce n’est pas le cas de la Suisse – ont la possibilité de recourir contre une décision prise par la dernière instance judiciaire de leur pays. Je décide quelles mesures provisoires doivent être prises d’ici à ce que le comité tranche sur le fond. Comme je suis l’un des deux juristes du comité, un autre aspect de mon travail consiste en la préparation de ses décisions, avec le soutien des spécialistes de l’ONU.
Un exemple?
Une Irakienne avec un handicap psychosocial s’est vu refuser l’asile en Suède. Elle a fait valoir qu’en retournant dans son pays, elle n’aurait pas accès aux soins médicaux dont elle a besoin. Elle risquerait de mourir dans les six mois. Il faut d’abord prendre une mesure provisoire, soit que la Suède suspende son rapatriement en attendant une décision de notre comité. Dans un tel cas, on applique le droit international reconnu, comme le droit de non-refoulement, en tenant compte des spécificités du handicap, comme le prévoit la CDPH.
Que se passe-t-il si l’Etat ne respecte pas la décision?
Dans les relations internationales, chacun est dépendant des autres. Pour parvenir à ses fins, un Etat doit être respecté, et ce respect se perd si l’on ignore une instance compétente. A cet égard, le fait que je sois citoyen d’un pays jouissant d’un tel respect facilite mon travail.
Qu’est-ce que cette convention?
Elle requiert que les personnes en situation de handicap soient reconnues comme des membres de la société à part entière. Pour atteindre ce but, il faut changer de perspective. Accepter le handicap comme une dimension de la diversité humaine et pas comme une pathologie. On en est très loin. L’organisation de notre société n’est pas pensée pour ces personnes. Qu’il s’agisse de l’éducation, du travail ou de l’architecture, il existe une ségrégation de facto dans la plupart des domaines de l’existence. Tous les pays ont un problème avec la convention. Et c’est l’intérêt de disposer d’un tel outil, qui décline précisément les actions à mener.
Votre mandat arrive à son terme et vous êtes candidat à votre succession. Comment fait-on campagne pour un tel poste?
En 2018, je ne connaissais rien à cet univers. C’est un processus passionnant durant lequel il faut s’entretenir avec les représentants du monde entier. Chaque pays disposant d’un vote, l’Eswatini (Swaziland) équivaut à la Chine. A Genève et à New York, les missions suisses auprès de l’ONU organisent des discussions afin de me présenter, d’expliquer ce que j’ai fait et ce que je compte faire. Il faut que les États cessent d’administrer les personnes en situation de handicap et poursuivent le but d’une véritable inclusion. Je dois aussi évoquer ma légitimité, étant un des trois membres du comité ne présentant pas de handicap.
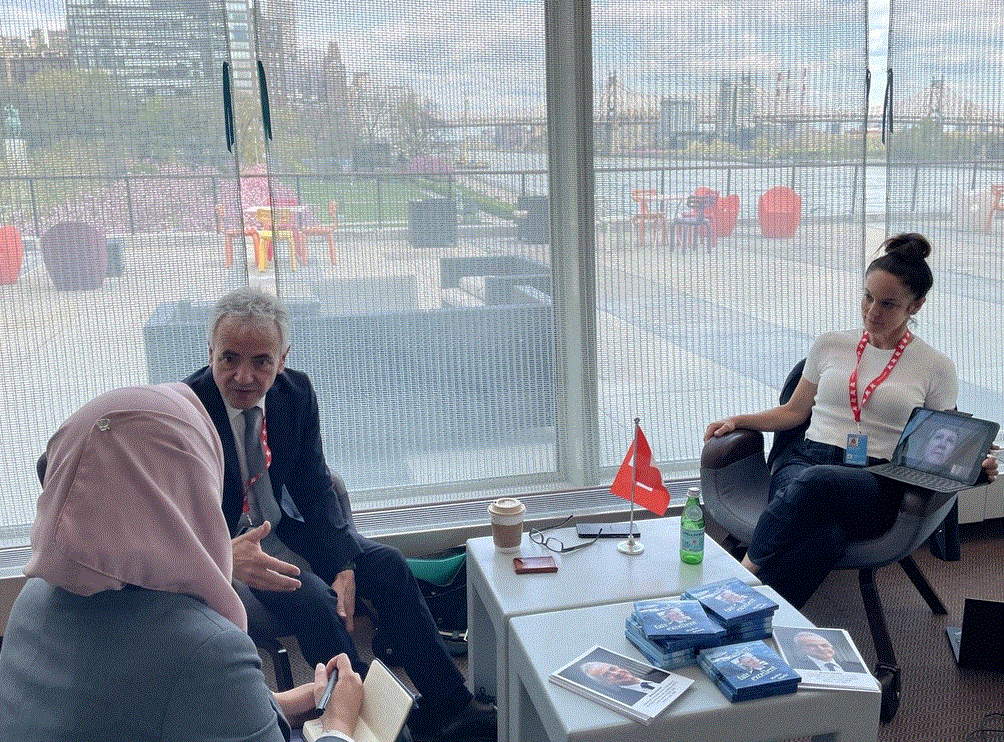
En discussion cette année avec une responsable de l’élection,
au siège de l’ONU, à New York
En tant que spécialiste du droit constitutionnel, qu’est-ce qui vous a conduit à promouvoir les droits des personnes handicapées?
Je n’ai pas de lien personnel avec ce sujet. Je travaille sur les droits humains depuis le début des années 1990. Le rôle d’un professeur demeure assez théorique. Après toutes ces années, j’ai voulu contribuer à obtenir des résultats concrets pour les personnes. Pour cela, il faut se spécialiser. Le handicap n’était pas un domaine juridique reconnu en Suisse. Nous y avons remédié en publiant un livre en 2014, avec Caroline Hess-Klein, d’Inclusion Handicap. C’est aussi l’année lors de laquelle la Suisse a ratifié la convention.
En Suisse, le nombre de personnes vivant avec un handicap est estimé à 1,8 million, soit 20% de la population. Dans le même temps, environ 25 000 adultes et enfants résident dans une institution. Qu’est-ce qu’un handicap?
Il n’existe pas de définition exhaustive. Le handicap est le résultat de deux facteurs conjugués: une incapacité et des barrières sociales. Cette situation est durable et comporte un effet négatif pour la personne concernée. L’existence d’une grande partie de ce 1,8 million de personnes est sévèrement restreinte. Mais la plupart d’entre elles sont invisibles. Cela donne la fausse impression qu’il s’agit d’un problème mineur.
La Suisse a ratifié la CDPH en 2014 et vient d’être évaluée par l’ONU. Sur les 17 pages du rapport rendu fin mars, il y a 8 lignes de «félicitations» et 15 pages de «préoccupations». Comment l’explique-t-on?
C’est préoccupant, mais pas surprenant. C’est la première fois que la Suisse est évaluée. Mes collègues du comité étaient assez surpris de l’état de la mise en œuvre de la convention. Ils s’attendaient à ce que, en Suisse, les choses fonctionnent. Ils ont cependant dû constater que l’administration ne savait pas vraiment comment s’y prendre. Etant de nationalité suisse, je n’ai moi-même pas participé à cet examen, afin de respecter l’intégrité du processus. Les membres du comité doivent rester indépendants.
Cette mise en œuvre est une tâche titanesque, non?
Absolument. Au XIXe siècle, l’égalité hommes-femmes était impensable. Le handicap constitue un défi analogue. C’est une affaire de décennies. Mais cela ne veut pas dire qu’il faille progresser lentement.
Pauvreté élevée, stérilisations forcées, droits politiques restreints, accès limité ou inexistant à l’éducation, au marché du travail et aux lieux publics: les personnes vivant avec un handicap sont-elles des sous-citoyens?
Pas toutes, mais la grande majorité le sont, oui. Elles ne peuvent pas participer à la société comme tout un chacun, parce que celle-ci a été créée par et pour des personnes qui n’ont pas de handicap. Nous ne sommes pas habitués à interagir avec des personnes en situation de handicap. Cela explique pourquoi la tâche est monumentale.
La législation parle d’invalidité ou d’impotence. Pourquoi ce lexique est-il critiqué?
Datant des années 1950, la loi sur l’invalidité (AI) était un projet magnifique à l’époque. Mais aujourd’hui, le terme, dévalorisant, véhicule l’idée d’une dépendance à l’Etat. On parle beaucoup du langage en relation avec les questions de genre ou des minorités sexuelles. Parce que, jusqu’à un certain point, la terminologie reflète ce que nous pensons. Mais je ne fais pas partie des radicaux dans ce domaine. Au final, ce sont les actes concrets qui comptent.
Pourrait-on simplement remplacer le terme «invalidité» par «handicap»?
Non, car les deux termes ne se recoupent pas complètement. L’invalidité correspond à une définition juridique, qui donne accès à des droits. L’AI compense l’absence de revenus pour les personnes qui ne peuvent pas travailler, situation qui ne rejoint pas celle de toutes les personnes en situation de handicap. Changer la terminologie peut créer une insécurité juridique.
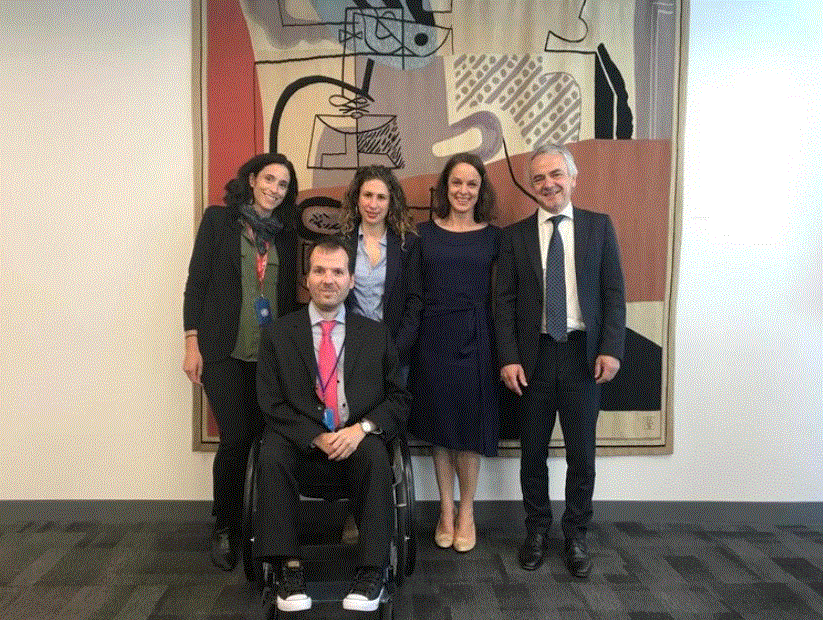
Entouré de la spécialiste des droits humains de la mission suisse à New York, Laetitia Kirianoff (à gauche) et de représentants d’Inclusion Handicap.
Et pourquoi les associations parlent-elles d’inclusion plutôt que d’intégration?
L’intégration part de l’idée que la personne doit s’adapter à la société, alors que l’inclusion demande à la société de s’adapter à la personne.
Le comité de l’ONU estime qu’en Suisse, «les médias renvoient généralement une image négative des personnes handicapées»…
Ce n’est pas mon impression. Les médias suisses sont très ouverts à la question des droits des personnes en situation de handicap. A Genève, ils ont fortement soutenu la restitution des droits politiques aux personnes sous curatelle [approuvée en 2020 par 74% de la population, ndlr]. Mais il est vrai que les médias ont globalement appuyé cette horrible législation sur la surveillance des bénéficiaires des assurances sociales [approuvée par le peuple suisse à 64,7% en 2018, ndlr]. Cette loi fait primer la traque à la fraude sur le respect de la vie privée et de la dignité des assurés. Elle mériterait d’être examinée sous l’angle de la discrimination des personnes en situation de handicap.
Le comité déclare que «les lois et les politiques ne sont pas pleinement en accord avec la convention et avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme». Qu’est-ce que cela veut dire?
Que les lois ne considèrent pas les personnes handicapées comme des personnes détentrices des mêmes droits humains, bénéficiant du même niveau de protection. Si vous êtes obligé d’aller en école spécialisée, vous êtes séparé des autres. Si vous vivez dans une institution isolée, à la campagne, vous ne pouvez aller en ville que sporadiquement. Si vous cherchez un emploi, vous serez très souvent rejeté. Et travailler dans un atelier protégé constitue souvent une obligation de fait.
Autre critique, «des lois nient ou restreignent la capacité juridique des personnes handicapées et prévoient leur mise sous tutelle». A quelles lois est-il fait allusion?
Au Code civil et à son dispositif de protection de l’adulte. Ce système de représentation est très ancien. Un curateur administre certains domaines de votre existence. Il est votre voix légale. Ce que vous pouvez dire n’a aucune incidence légale. La convention rejette ce système: le curateur ne doit pas décider à la place d’une personne, mais l’aider à s’exprimer. Si elle ne le peut pas, il doit trouver la meilleure interprétation possible de ce qu’elle veut. La Suisse n’est pas en conformité avec cet aspect fondamental de la CDPH.
Que signifient les notions de libre choix et d’autonomie?
Changer d’approche et développer des méthodes afin de pouvoir interpréter ce que la personne exprime, parfois de façon non verbale. Si l’on prend la loi sur la stérilisation, le processus est strict et bien encadré. Mais on peut ignorer un refus catégorique d’une personne en situation de handicap. Au vu de notre histoire compliquée avec la stérilisation, il est étonnant que le législateur n’ait pas songé à ce problème.
La Suisse se focalise sur l’hébergement en milieu institutionnel. Pourquoi cette approche est-elle jugée problématique?
Tout un chacun veut pouvoir choisir où il vit, avec qui et de quelle manière. C’est essentiel. Personne ne peut me forcer à accueillir un réfugié ukrainien. Je choisis de le faire ou non. Une telle contrainte n’existe qu’à l’armée ou en prison, durant une période limitée. Pour les personnes en situation de handicap, ça peut être toute leur vie. Le fait que personne n’aime la perspective de vivre dans un EMS devrait nous amener à faire preuve de davantage d’empathie. Durant la pandémie, de nombreuses institutions se sont transformées en prison. Cela a été catastrophique.
Est-il réaliste de supprimer toutes les institutions?
La Nouvelle-Zélande l’a fait il y a 20 ans. Cela n’a pas supprimé tous les problèmes, mais le système fonctionne. Mon collègue néo-zélandais du comité, Sir Robert Martin, a vécu plus de trente ans dans une institution, avant d’en être libéré. Il évoque un changement fondamental dans son existence.
Il vit donc seul à la maison?
Pas du tout. Il bénéficie d’un soutien personnalisé. On dépense beaucoup pour les institutions. Cet argent peut être utilisé pour fournir un autre type d’accompagnement.
Existe-t-il une comparaison du coût des deux systèmes?
Pas à ma connaissance. Il est très compliqué de comparer les systèmes d’assurances sociales.
Les prestations des assurances sociales favorisant le maintien des personnes handicapées à domicile ont été élargies. Qu’en pensez-vous?
En effet, la contribution d’assistance de l’AI est un développement récent. Elle permet d’employer une personne à domicile par exemple. C’est un bon début.
Existe-t-il d’importantes disparités cantonales dans la mise en œuvre de la CDPH?
Oui, comme toujours en Suisse. Quelques cantons, comme les deux Bâles ou le Valais, ont des lois adéquates sur l’autodétermination, faisant de l’inclusion un droit garanti, même s’il est relativisé par la proportionnalité. Zurich a des plans d’action, mais pas de loi. Genève et Glaris s’y attellent. Mais certains cantons sont à la peine.
Vous avez été mandaté par l’Etat de Genève pour élaborer une politique du handicap. Que pouvez-vous en dire à ce stade?
On m’a proposé de travailler sans tabou, même s’il faut rester réaliste, car au final le politique décide. On a fait un diagnostic, analysé des lois genevoises, et développé des priorités pour avancer. L’administration considère ces questions avec le sérieux nécessaire. Je ne peux pas en dire davantage.
L’ONU dit que les procédures de signalement de la maltraitance sont défaillantes. Cela évoque ce qui s’est passé au foyer pour mineurs de Mancy et les dysfonctionnements constatés chez les adultes de Clair Bois…
Ces problèmes de signalement sont récurrents. Ces processus doivent être changés de façon à garantir l’accès à ceux qui en ont besoin. C’est aussi valable pour l’accès à la justice, un thème que j’entends porter si mon mandat est reconduit.
On frissonne en lisant que le «recours, sans le consentement des intéressés, à des procédures et traitements médicaux, des moyens de contention chimique, physique et mécanique et des mesures de mise à l’isolement» existent encore…
Le Code civil autorise ces pratiques, qui sont employées quotidiennement. Au niveau cantonal, les dispositions régissant la psychiatrie les permettent aussi. La culture médicale doit changer. J’ai récemment été invité à Malte pour parler devant 300 psychiatres. Comme souvent, les anciennes générations ne voient pas comment changer, alors que les jeunes l’estiment possible.
Questionnaire de Proust
Que lisez-vous en ce moment?
«Anéantir» de Michel Houellebecq, en français.
Votre couleur préférée?
Le vert.
Un lieu pour vous ressourcer?
La maison.
Le défaut qui vous révulse?
Penser qu’on est le plus important. Me, myself and I.
Une qualité qui vous inspire?
La faculté d’accepter les personnes comme elles sont.
Si vous pouviez exercer un autre métier?
Aucun. Mais je caresse le rêve étrange d’enfouir des bidons jaunes et vides dans le désert du Nouveau-Mexique et que personne ne sache que ces œuvres d’art s’y cachent. Hélas, je ne le ferai jamais.
L’animal qui vous correspond?
Nous sommes des animaux. Ma fille biologiste m’interdirait toute autre réponse.
Profil
Naissance le 4 février 1965 à Teufen, Argovie. Il est père de deux filles, jeunes adultes.
Ponctuant ses études à l’Université de Berne ainsi qu’à Berkeley et à Washington, il soutient en 1995 sa thèse de doctorat sur les méthodes d’interprétation de la Constitution par la Cour suprême américaine lorsqu’elle est saisie de questions touchant aux droits fondamentaux.
Markus Schefer occupe la chaire de droit constitutionnel de l’Université de Bâle depuis 2001.
En 2019, il devient membre du Comité de l’ONU chargé de veiller au respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il brigue un second mandat de quatre ans.